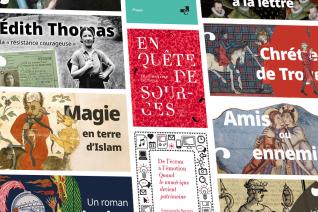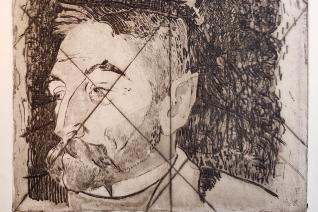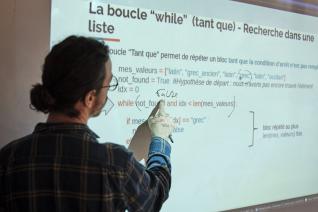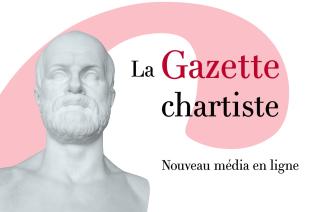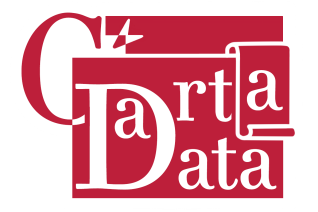Actualités
341 résultats
(Re)découvrir les ressources de l’École pendant la fermeture estivale
Actualité
Publié le 30/06/2025
Éléonore Quirouard-Frileuse (prom. 2025) lauréate du « Prix Fondation Etrillard »
Actualité
Publié le 26/06/2025
Avis de vacance de fonctions de directeur de l’École nationale des chartes - PSL
Actualité
Publié le 25/06/2025
Michelle Bubenicek nommée rectrice déléguée de la région académique Hauts-de-France
Actualité
Publié le 11/06/2025
Accueil de la signature de la convention « Agir ensemble pour des campus durables »
Actualité
Publié le 10/06/2025
Résultats d’admissibilité au concours d’entrée en première année, sections A et B (2025)
Actualité
Publié le 02/06/2025