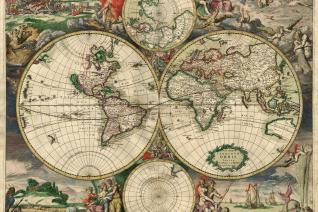Et si on pouvait recréer ce qui a été perdu ? N’est-ce pas le rêve de tous les historiens, de tous les scientifiques ? Certains veulent rebâtir le Palais des Tuileries, incendié en 1871 ; d’autres ont entrepris de reconstruire la flèche nord de l’abbatiale de Saint-Denis, démontée en 1846 ; dans un film à grand spectacle de mon enfance, des scientifiques recréaient même des dinosaures à partir de l’ADN conservé grâce à un moustique pris dans de l’ambre !
Par Rémi Mathis, directeur adjoint de la bibliothèque de l’École nationale des chartes - PSL[1].
Les historiens de l’estampe ont à cet égard un gros avantage sur les autres : cette recréation est parfois possible et ne demande ni des trésors d’ingénierie, ni des technologies de l’avenir, ni des budgets faramineux. C’est ce que nous avons fait pour l’estampe que l’on peut consulter à la bibliothèque de l’École des chartes sous la cote 4Est10. Reprenons donc l’histoire d’un passionnant document du XVIIIe siècle, telle qu’elle s’est déroulée.
Une matrice de cuivre étrange et inconnue
En février 2024, passe en vente aux enchères à l’hôtel Drouot (SSV Audap, vente classique du 2 février 2024, lot 56) une « matrice ». On appelle « matrice » la planche de bois ou de cuivre que l’on va graver, puis enduire d’encre et passer sous presse afin qu’elle laisse sa trace sur un papier humide : le résultat – l’empreinte de la matrice sur le papier – s’appelle une estampe, et c’est l’unique moyen de multiplier une image pendant près de cinq siècles en Occident (environ 1350-1830, pour schématiser).
En l’occurrence, cette matrice n’attire pas l’attention de grand monde. L’expert ne met pas beaucoup de cœur à sa description. En voici l’intégralité : « Plaque de gravure en cuivre (Accidents.) Haut. : 25 cm ; Larg. : 16,3 cm ». Estimée à 20-30 euros, elle part pour 20 (26 avec les frais). Peu de gens achètent de telles plaques et ce mot de « matrice » n’était ici même pas cité, ce qui rendait son repérage difficile dans une vente générique de « tableaux, mobilier, objets d’art ». Mais cet achat est fait en mon nom propre : l’École des chartes possède déjà les nombreuses matrices des fac-similés qu’elle a produits, il n’est sans doute pas pertinent d’en acheter une nouvelle.

Adélaïde-Marie Quatremère, Hommage à M. Quatremère, matrice de cuivre, 1775, collection particulière
Pourtant, cette pièce est assez passionnante. Pour le comprendre, il fallait la regarder de près, l’étudier – ce n’était pas possible de le faire en lisant uniquement le catalogue de vente. La plaque est très sale, rayée, en un état plus que médiocre. On y voit un personnage féminin, qui s’approche d’un buste sculpté, avec un cadeau – apparemment la plaque ou l’estampe elle-même, dans une mise en abyme du présent. Le tout est gravé à l’eau-forte de manière hésitante – ce n’est pas une œuvre d’art de premier rang. Pour comprendre définitivement de quoi il s’agit, il faut comme souvent lire la « lettre », c’est-à-dire le texte qui accompagne l’image. On y lit donc, en gros caractères « Dédié à M. Quatremère / Par sa très respectueuse fille Adelaide Marie Quatremere » ; et en plus petit « Inventé par David / Gravé par A. M. Quatremere en 1775 ».
La gravure comme activité artistique d’amateur
Le conservateur sera alors capable de remettre le document en contexte : on sait que l’apprentissage de la gravure, tout comme du dessin, participe à l’éducation ordinaire des jeunes gens et jeunes filles de bonne famille, sous l’Ancien Régime. Les gravures d’amateurs sont un phénomène qui a été étudié, notamment à partir de quelques portefeuilles conservés au département des Estampes de la BnF. Car ces estampes n’étaient pas destinées à être diffusées, vendues, ni même forcément conservées : elles sont donc excessivement rares, alors même qu’elles documentent un phénomène important de l’histoire de l’art, de la diffusion du goût, de l’éducation, des pratiques artistiques et intellectuelles sous l’Ancien Régime.
En l’occurrence, Adélaïde-Marie Quatremère était en 1775 une jeune fille de 18 ans – née le 16 décembre 1756. Elle appartient à une bonne famille de la bourgeoisie parisienne : elle est une lointaine cousine du savant Quatremère de Quincy ; sa mère a été femme de chambre du petit duc de Berry, neveu du roi ; son père Jean Quatremère (1731-1801), ancien marchand, a été garçon de la chambre de Mademoiselle. Elle-même devient femme de chambre du duc d’Angoulême, autre neveu du roi, et épouse en 1780 Nicolas Bernier de Vallois, commis de la Guerre, originaire de Lorraine. Elle meurt en 1828 à l’âge de 71 ans.
Adélaïde-Marie se représente donc elle-même sur cette gravure, en train de faire un geste de piété filiale, dans un charmant geste d’amour d’une jeune fille pour son papa. Sans doute l’estampe a-t-elle été offerte à Jean Quatremère pour une occasion – anniversaire, étrennes... Au-delà de l’histoire technique de l’estampe, on y voit également un document sur les relations familiales, dans la plus stricte intimité d’une famille parisienne de la fin de l’Ancien Régime, ainsi que sur la place, le rôle et les pratiques des femmes.
Mais, rappelons-le, aucune estampe issue de cette matrice n’a survécu jusqu’à nous : ces feuilles de papier sont trop fragiles pour être conservées si ce n’est pas le fruit d’une volonté positive de garder ces documents éphémères. L’estampe est morte avec l’amour qui liait ces deux personnes d’un autre temps.
Sauf que…
Une matrice est faite pour servir à tirer des estampes. Le but a même longtemps été d’être en mesure d’en tirer le plus grand nombre possible ! Cela n’abîme pas particulièrement la plaque, et celle-ci est déjà en assez mauvais état. Pourquoi ne pas imprimer un exemplaire supplémentaire de cette gravure, puisque tous les autres ont disparu ?

Adélaïde-Marie Quatremère, Hommage à M. Quatremère, 1775, estampe tirée dans l'atelier de Maxime Préaud en 2024. Bibliothèque de l’École nationale des chartes - PSL, 4Est10
Recréer l’œuvre disparue : une estampe unique pour l’École des chartes
C’est là qu’intervient le grand intérêt de l’organisation de l’École des chartes, où le document, l’archive, la trace, jouent un grand rôle et où les conservateurs se font donc enseignants. Lors d’un stage organisé par la formation continue à destination des professionnels des bibliothèques, je me munis donc de ma plaque de cuivre car nous allons visiter l’atelier de Maxime Préaud, ancien conservateur – le meilleur connaisseur au monde de l’estampe ancienne française – mais aussi graveur à ses heures perdues et personnage aussi pittoresque qu’attachant et érudit. Maxime Préaud nous montre comment nettoyer, encrer puis imprimer une matrice sur sa petite presse, dans une cave du XIIIe arrondissement de Paris : ce sont des gestes qui n’ont guère changé depuis la fin du Moyen Âge. Pourrait-il tirer un exemplaire à partir de cette matrice ? Bien sûr, bien qu’elle ne soit pas en très bon état – le tirage sera ce qu’il sera… Allons-y !
Et nous voilà, pour la première fois depuis 250 ans, en possession d’un tirage de la matrice. C’est cette estampe qui a intégré les collections de l’École des chartes – on n’en connaît pas d’autre exemplaire au monde, ce qui en fait un document exceptionnel. De quand date-t-elle ? De 1775 ou de 2024 ? Un peu des deux : une estampe est un objet complexe, et c’est cela aussi que l’on expliquera à nos étudiants à travers cet exemple.
Un livre, une estampe, une œuvre d’art ne sont pas des objets figés, qui ne bougeraient plus après leur création par un artiste de génie ou un artisan d’art : ce sont des objets vivants, qui racontent une histoire à laquelle nous participons encore. Acquérir un document pour une bibliothèque, ce n’est pas signer un chèque et le ranger dans une armoire, mais cela peut devenir une aventure intellectuelle et humaine. Cette fois, nous avons eu la joie de récréer, de faire revivre, une estampe qui n’existait plus, et peut-être un peu de l’amour réciproque entre une jeune fille et son père.

Adélaïde-Marie Quatremère, Hommage à M. Quatremère, détail
Intervenant(s)
- [1]
« L’estampe qui n’existait plus », rubrique « Pépites de la bibliothèque de l’École », Gazette chartiste, n° 3, 2025.